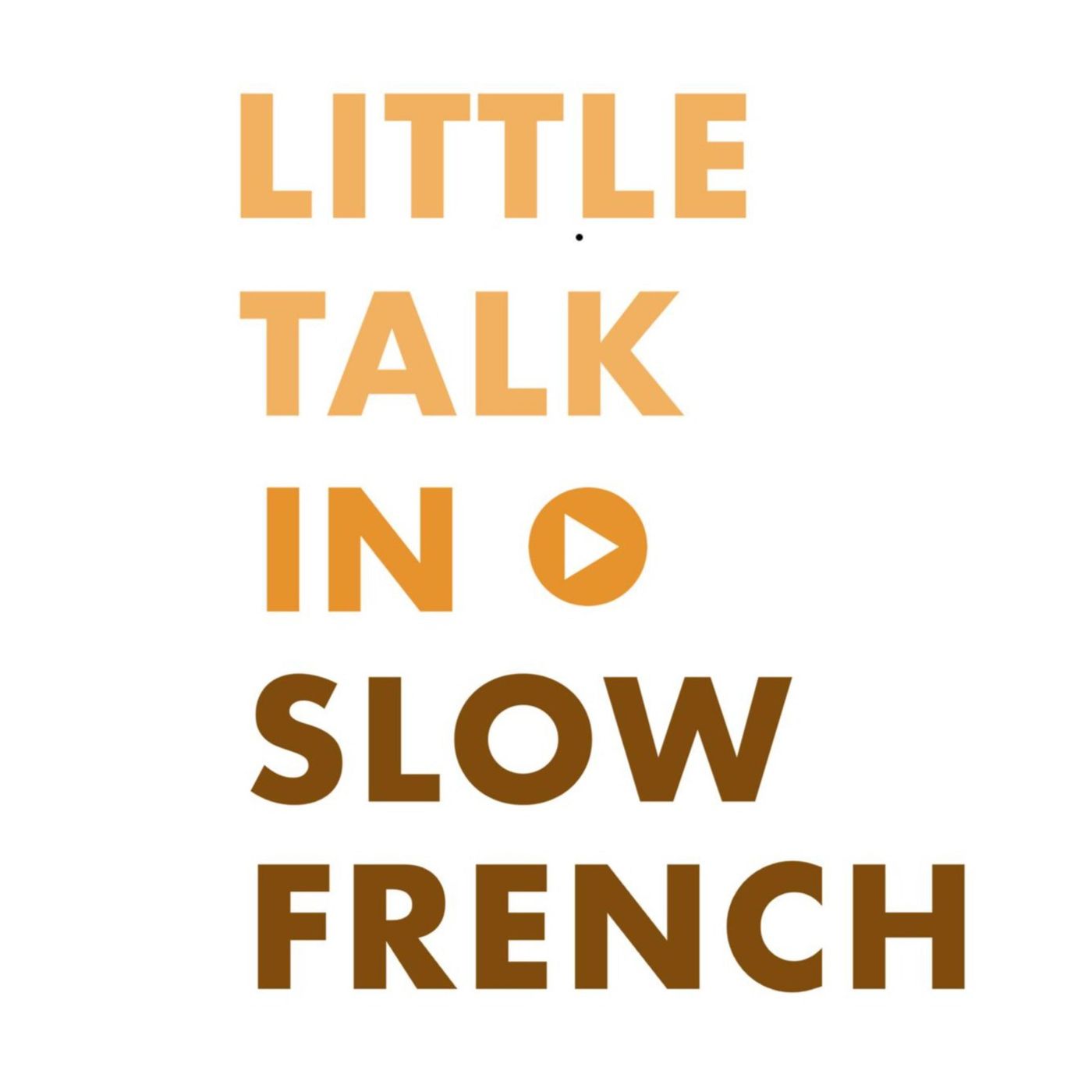
1/3|L'évolution des inégalités : de la Révolution française à aujourd'hui
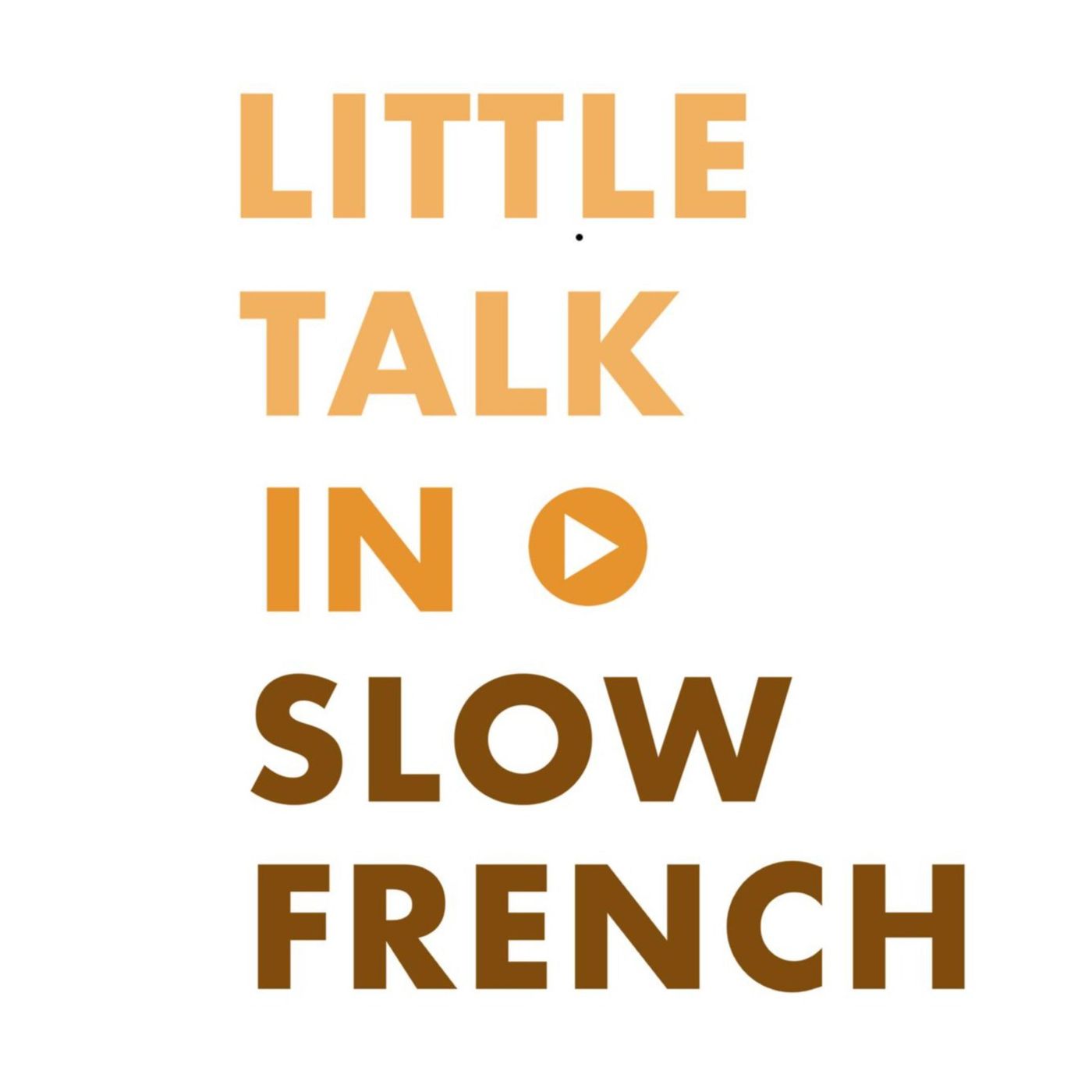
Little Talk in Slow French
Deep Dive
Shownotes Transcript
À H&R Block, obtenez 100% d'accurité et votre garantie de rémunération max. Visitez-nous à la suite 122 à Broadlands ou appelez 571-291-2216. Toutes les situations de taxe sont différentes. Pas tout le monde obtient un rémunération. Les limites s'appliquent. Voyez hrblock.com.
Avant de commencer, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement et je vous conseille vraiment de la consulter car cet épisode sera un peu difficile. Dans la transcription, j'ai rajouté quelques traductions en anglais pour vous aider. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode.
Liberté, égalité, fraternité. Vous avez sûrement déjà entendu ces trois mots ensemble. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise officielle de la République française. Mais est-ce que dans la réalité, la France est vraiment un pays égalitaire ?
Dans une série de trois épisodes, on va analyser un peu l'évolution des inégalités en France et dans le monde à travers les années. On verra les conséquences des inégalités sur nos sociétés et on verra quels sont les pays les plus égalitaires et quels sont les pays les plus inégalitaires.
Les pays les plus égalitaires, donc les pays où il y a le plus d'égalité. Et le contraire, les pays les plus inégalitaires, donc les pays où il y a le plus d'inégalité. Et pour parler de tout ça, je suis très heureuse d'avoir interviewé l'économiste Idan Gidron.
Après avoir travaillé à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, Idan Jidron travaille à présent à l'Observatoire européen de la fiscalité. Un observatoire dirigé par le célèbre économiste Gabriel Zucman. Gabriel Zucman, il a été professeur à la London School of Economics ou encore à l'Université de Berkeley.
Et Gabriel Zucman, il travaille souvent avec un autre économiste français très connu et qui est le directeur du World Inequality Lab, Thomas Piketty.
Donc voilà, deux économistes français, Thomas Piketty et Gabriel Zucman, et notre invité du jour, Idan Gidron, qui n'est pas français mais qui est belge, donc de Belgique, plus précisément de Bruxelles. Vous allez donc entendre un accent un peu différent du mien. Une dernière chose, je précise que parler de ce type de sujet, c'est pas facile, parce que ce sont des sujets communs,
complexe et ça touche à la politique, ce qui est toujours délicat. Mais c'est aussi l'objectif de ce podcast, vous aider à comprendre des sujets un peu plus difficiles en français.
Pendant l'interview avec Idan, on se base sur différentes études et sur les données, les datas collectées par l'observatoire pour lequel il travaille. Et je précise aussi que, bien sûr, parler d'égalité et d'inégalité, c'est un vaste sujet. Et comme Idan Gidron est économiste, on va surtout se concentrer sur les inégalités économiques. Mais bien sûr, elles ont une influence sur d'autres types économiques.
d'inégalités. Et donc, pour évaluer un peu l'évolution des inégalités en France, on va démarrer à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française. Car un des objectifs de cette révolution, c'était d'obtenir une égalité des droits. Les droits, c'est ce qui est permis, ce qui nous est possible. Par exemple, on dit les droits civils.
Et donc un des objectifs de la Révolution française, c'était d'obtenir une égalité des droits. Parce qu'avant la Révolution française, la société française était très inégale. Et pour comprendre d'où vient cette inégalité, il est important de comprendre comment la société française était structurée.
Avant la Révolution française, la France était une société d'ordre. Donc il y avait trois ordres principaux : la noblesse, le clergé et le tiers-État.
Chaque ordre avait un rôle spécifique défini dans la société. Par exemple, la noblesse avait un rôle militaire et de sécurité. Elle assurait la sécurité dans la société. Le clergé, c'est tout ce qui est lié à l'église, c'est la classe religieuse qui avait un rôle de leader spirituel et elle assurait aussi beaucoup de services sociaux comme par exemple l'éducation.
Et enfin, le tiers état, c'était la classe la plus grande en nombre
Et c'est là que se trouvaient tous les travailleurs. Donc les artisans, les agriculteurs, etc. Dans la société d'ordre en France avant la Révolution française, les classes sociales sont très rigides. D'un côté, on a la noblesse et le clergé qui détiennent le pouvoir économique et politique. Donc qui possèdent, qui détiennent ou qui possèdent. C'est ça. Et de l'autre côté, on a le tiers-État qui...
qui produisent la plupart des biens de consommation pour l'ensemble de la société. Parce qu'en effet, comme tu dis, c'était des artisans, c'était des agriculteurs. Donc en effet, ils produisent de la nourriture, par exemple, tout simplement, des ustensiles. Les ustensiles, c'est « tools », des ustensiles, etc. ?
Exactement. Et puisque la société est très rigide, elle est très inégalitaire. C'est difficile pour les gens de passer d'une classe sociale à une autre.
Donc, avant la Révolution française, la France est très inégalitaire. L'objectif de la Révolution française, c'est de mettre en place des nouvelles structures qui sont idéalement plus égalitaires. Je vais parler de deux structures principales. D'un côté, ils veulent mettre en place un État central qui va remplacer certains pouvoirs qu'avaient la noblesse et le clergé avant la Révolution.
Donc tout ce qui est assurer la stabilité de la société ou la sécurité dans la société vont être des rôles pris par l'État central. Et notamment, et ça c'est important pour la Révolution française, l'État central va aussi assurer l'égalité des droits.
Car pendant la Révolution française, les Français mettent en place la Déclaration universelle des droits de l'homme qui définit l'égalité des droits pour tous les Français. Ouais, alors juste je précise, donc cette déclaration, elle est très importante. Quand on est à l'école en France, on apprend cette Déclaration des droits de l'homme. Et donc, vas-y, continue, pardon. Donc l'État central va assurer tout ça. Hum hum.
De l'autre côté, une autre institution importante qui va être mise en place avec la Révolution française, c'est la propriété privée. Généralement parlant, c'était le clergé et la noblesse qui possédaient la plupart des propriétés, que ce soit des terres ou des propriétés immobilières en France. Ouais, les terres, c'est l'Inde, les terres. Et après la Révolution, la propriété privée devient un droit pour tout.
D'accord. Cependant, au changement entre avant et après la Révolution, beaucoup de terres et de propriétés immobilières qui appartenaient aux classes dominantes avant la Révolution sont transformées en propriétés privées qui appartiennent aux mêmes personnes après la Révolution. Donc ça passe de la noblesse et le clergé à la noblesse et le clergé ?
C'est ça que ça veut dire ? C'est ça que ça veut dire. En termes de qui appartient la propriété avant et après, c'est la même chose. Sauf que là, on a mis en place une institution qui est la propriété privée et qui, par définition, donne un accès égalitaire à tout le monde et
Et donc, par la manière dont elle est construite, elle peut être vue comme plus juste. Mais en pratique, les propriétés, elles restent dans les mains des mêmes personnes. Donc, pour bien comprendre, en conclusion, entre la Révolution française et le début de la Première Guerre mondiale, les inégalités, elles n'évoluent pas. Et même, comme tu dis, elles augmentent un petit peu. Donc, c'est un peu un échec, on peut dire, de la Révolution française là-dessus ?
Oui, et c'est important de faire savoir ça aux Français et au monde, parce que pour beaucoup de Français, la Révolution française est une grande victoire.
Mais en effet, quand on regarde en pratique, ça n'a pas beaucoup affecté l'évolution des inégalités. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant les guerres mondiales ? Donc, on a bien sûr la première guerre mondiale et ensuite, plus tard, la deuxième guerre mondiale. En français, on peut dire deuxième ou seconde guerre mondiale, c'est comme vous préférez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment évoluent les inégalités ?
Alors, pour parler de la période suivante, on peut regarder plus généralement entre 1914 et 1980, qui est une période où en effet il y a les deux guerres mondiales, mais il y a aussi une grande évolution vers l'égalité.
Entre 1914 et 1945, les deux guerres mondiales, elles diminuent les inégalités parce que d'un côté la guerre cause beaucoup de destruction et donc beaucoup des propriétés sont détruites et si les propriétés sont distribuées de manière inégalitaire, alors les riches perdent plus que les pauvres à cause de cette destruction.
C'est assez logique. Bien sûr, en fait, les riches, vu qu'ils ont beaucoup de possessions, beaucoup de propriétés, ils ont plus à perdre. Exactement. Et en plus, pendant les guerres,
Les pays sont en économie de guerre et donc beaucoup d'industries se ferment totalement. Par exemple, il y a des magasins entiers qui vont se fermer puisque une grande partie de la population est sur le front. Il y a beaucoup de soldats et d'autre part, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire avant la guerre mais qu'on ne peut pas faire pendant la guerre. Et donc, voilà.
Beaucoup de magasins se ferment, beaucoup de propriétaires qui gagnaient de l'argent grâce à certaines activités économiques, ils perdent dans leur richesse et dans leur revenu à cause des conséquences économiques de la guerre. Et est-ce qu'il y a aussi les populations les plus riches participaient financièrement, non ? Ils donnaient une partie de leur argent pour participer à la victoire ?
Alors, c'est une question importante car, en effet, dans un pays comme la France, 1914, c'est l'année où la France met en place pour la première fois un impôt progressif sur le revenu. Donc, c'est une taxe.
sur le revenu que payent tous les citoyens français. Et un impôt progressif, ça veut dire que plus ton revenu est élevé, plus tu vas payer en taxes pour contribuer au pays. Donc en gros, plus tu es riche, plus tu as de l'argent et plus tu vas payer une taxe élevée.
Oui, ça c'est... Ça c'est l'impôt progressif sur le revenu. Exactement. Et donc en effet, le début de la guerre voit en parallèle le début d'un impôt progressif en France. Néanmoins, dans d'autres pays, il y a déjà un impôt progressif avant la guerre. Ah d'accord. Donc nous en France, c'est vraiment pour la guerre qu'on a mis en place cet impôt progressif sur le revenu. Exactement. Et c'est ça qui a permis notamment plus d'égalité. Voilà.
Et donc ça, c'est en effet une raison additionnelle pour l'évolution des inégalités entre 1914 et 1980. C'est que petit à petit, les différents pays en Europe et dans le monde...
voient leur état social se développer. Tu peux expliquer, ouais, c'est quoi l'état social ? L'état social, the welfare state, c'est un état où plus de taxes sont collectées sur les individus et donc il y a plus de ressources pour le gouvernement et le gouvernement va dépenser plus d'argent pour la société. Donc il va y avoir plus de services sociaux comme par exemple l'éducation pour tous.
Ou la santé pour tous. La santé, c'est « health ».
Donc la santé devient beaucoup plus accessible, l'éducation devient beaucoup plus accessible, parce que donc c'est quelque chose qui est mieux redistribué. Exactement. Et donc en effet, c'est dans ces années-là que beaucoup de pays en Europe voient d'abord l'éducation primaire et ensuite l'éducation secondaire obligatoire pour tout le monde dans la société. Et ça, ce sont des transformations qui vont énormément affecter l'évolution des inégalités en Europe au courant du XXe siècle.
ces changements de politique publique, parfois ils sont liés à la guerre, mais parfois ils sont liés simplement à des changements idéologiques et politiques dans les pays. Par exemple, aux États-Unis, déjà après 1850, il y avait l'éducation obligatoire pour l'éducation primaire. Ailleurs, au Danemark par exemple, il y avait déjà un impôt progressif avant 1900. Donc chaque pays a sa propre trajectoire.
Dans le cas de la France, c'était lié à la guerre, mais c'est pas partout comme ça. Et donc tu dis que c'est jusque dans les années 80, donc in the 80s, les années 80, c'est jusque dans les années 80 que les inégalités ont diminué. Et qu'est-ce qu'il se passe à partir des années 80 ?
Donc les années 80, c'est les années des révolutions Thatcher et Reagan. C'est le moment d'un changement idéologique. Ok, donc juste pour préciser, Margaret Thatcher, c'est donc au Royaume-Uni et Ronald Reagan, c'est aux États-Unis.
Exactement, et ce sont deux chefs d'État qui vont mettre en place des politiques publiques qui vont affecter énormément l'évolution des inégalités après 1980.
Ce qui se passe en 1980, c'est que d'un côté, il y a la fin de l'empire soviétique, de l'URSS, et donc c'est la fin de l'alternative idéologique au capitalisme. D'accord, donc le communisme. Et ce qui est important, c'est que globalement, c'est l'idéologie communiste qui est en déclin à partir des années 80, avec en parallèle la chute de l'empire soviétique.
Et donc l'idéologie capitaliste a plus d'espace pour se développer.
Et les chefs d'État, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, sont élus grâce à une idéologie qui est de dire que l'État doit moins intervenir dans l'économie et que si l'État intervient moins dans l'économie, il y aura plus de croissance et les entreprises pourront gagner plus d'argent et cet argent pourra arriver dans les poches de toute la société. Donc ça, c'est le libéralisme ?
Exactement. Donc c'est le début d'une nouvelle doctrine, ou en tout cas, cette doctrine-là, elle prend plus d'espace à partir des années 80. Donc on veut vraiment avoir moins de contrôle de l'État sur l'économie, et c'est pour ça que ça s'appelle le libéralisme. C'est avoir, en gros, plus de liberté pour les acteurs économiques.
Exactement. En pratique, ce que ça implique au niveau des politiques économiques, c'est que beaucoup des politiques publiques qui étaient mises en place entre 1914 et 1980, la création de l'État social...
sont diminuées. Donc, par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé dont on parlait tout à l'heure, tout ça, c'est donc un peu limité, quoi. C'est limité dans... Par exemple, si on prend l'éducation, on voit que les dépenses publiques
jusqu'en 1980, dans le secteur de l'éducation, elles n'ont fait qu'augmenter. Et à partir de 1980, elles se stabilisent. Elles n'augmentent plus. Et même dans certains pays, elles diminuent. Les dépenses spendings, donc les dépenses publiques, diminuent. Donc, d'un côté, il y a le changement de politique publique qui implique que l'État a
à moins d'impact sur l'économie et ça c'est la libéralisation des marchés et ça en effet ça va affecter les inégalités elles vont augmenter car il y a moins par exemple d'impôts progressifs mais
Mais à côté de ça, il y a d'autres transformations comme la globalisation qui devient plus intense à partir des années 80. Donc c'est la globalisation du marché économique. Exactement. Et donc c'est le fait que des entreprises américaines peuvent...
avoir des activités économiques dans d'autres pays sur Terre et avoir plus de bénéfices. Donc ça, c'est la création de l'entreprise multinationale. Par exemple, on va produire dans un autre pays. On va aller produire en Chine surtout, dans le continent asiatique, pour diminuer les coûts de production. Les coûts, c'est « cost », par exemple, j'imagine. Exactement. Le mélange entre, d'un côté, la globalisation et, de l'autre côté, la diminution de l'état social...
vont faire que certaines grandes entreprises vont devenir économiquement de plus en plus fortes. Et ça, ça va affecter énormément les inégalités. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus d'inégalités, monétaires en tout cas, que pendant la période des guerres mondiales ? Si on compare entre 2020 et 1914, 1914, c'est avant que les inégalités baissent, les inégalités sont comparables.
Aux États-Unis, les inégalités sont plus élevées aujourd'hui qu'en 1914. En France, elles sont moins élevées qu'en 1914 mais elles restent à un niveau comparable. Dans les années 50, 60, 70,
les inégalités étaient au plus bas dans beaucoup de pays. Et donc, c'était le fruit de trois changements. Un côté, les guerres, les destructions qu'elles causent, aussi l'évolution de l'État social. Et donc, tout ça ensemble a fait que, dans les années 1970, les inégalités étaient au plus bas, beaucoup plus basses qu'aujourd'hui. C'est globalement ça ? En tout cas, dans le monde occidental, c'est en général, c'est le cas.
Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup par rapport au monde occidental. Désolée pour les personnes qui ne sont pas en Occident. C'est vrai que quand on voit même l'histoire en France, on voit beaucoup selon le point de vue occidental. Mais en tout cas, dans le monde occidental, aujourd'hui, on a plus d'inégalités qu'après les guerres mondiales.
Voilà, qu'en 1970. Donc 1970, ça c'est comme on dit en Belgique, comme tu disais au dernier épisode. En France, on dit « 1970 » et en Belgique, on dit « 1970 ».
Voilà, j'espère que ce premier épisode de cette série sur les inégalités vous a intéressé. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon podcast sur Patreon. Sans vous, ce ne serait pas possible pour moi de continuer de produire tous ces épisodes. Donc un grand merci.
J'espère aussi que la transcription vous a aidé à bien suivre la conversation. Et au prochain épisode, on parlera des conséquences des inégalités sur nos sociétés. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao ciao !
Sous-titrage Société Radio-Canada